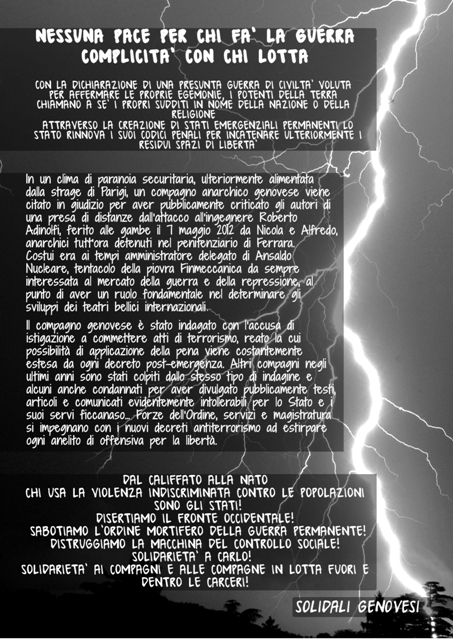(27 avril 1894)
« Messieurs les jurés,
Vous connaissez les faits dont je suis accusé : l’explosion de la rue des Bons-Enfants qui a tué cinq personnes et déterminé la mort d’une sixième, l’explosion du café Terminus, qui a tué une personne, déterminé la mort d’une seconde et blessé un certain nombre d’autres, enfin six coups de revolver tirés par moi sur ceux qui me poursuivaient après ce dernier attentat.
Les débats vous ont montré que je me reconnais l’auteur responsable de ces actes.
Ce n’est pas une défense que je veux vous présenter. Je ne cherche en aucune façon à me dérober aux représailles de la société que j’ai attaquée. D’ailleurs je ne relève que d’un seul Tribunal, moi-même ; et le verdict de tout autre m’est indifférent. Je veux simplement vous donner l’explication de mes actes et vous dire comment j’ai été amené à les accomplir.
Je suis anarchiste depuis peu de temps. Ce n’est guère que vers le milieu de l’année 1891 que je me suis lancé dans le mouvement révolutionnaire. Auparavant, j’avais vécu dans des milieux totalement imbus de la morale actuelle. J’avais été habitué à respecter et même à aimer les principes de patrie, de famille, d’autorité et de propriété. Mais les éducateurs de la génération actuelle oublient trop fréquemment une chose, c’est que la vie, avec ses luttes et ses déboires, avec ses injustices et ses iniquités, se charge bien, l’indiscrète, de dessiller les yeux des ignorants et de les ouvrir à la réalité. C’est ce qui m’arriva, comme il arrive à tous. On m’avait dit que cette vie était facile et largement ouverte aux intelligents et aux énergiques, et l’expérience me montra que seuls les cyniques et les rampants peuvent se faire une place au banquet. On m’avait dit que les institutions sociales étaient basées sur la justice et l’égalité, et je ne constatais autour de moi que mensonges et fourberies. Chaque jour m’enlevait une illusion. Partout où j’allais, j’étais témoin des mêmes douleurs chez les uns, des mêmes jouissances chez les autres. Je ne tardais pas à comprendre que les grands mots qu’on m’avait appris à vénérer : honneur, dévouement, devoir, n’étaient qu’un masque voilant les plus honteuses turpitudes. L’usinier qui édifiait une fortune colossale sur le travail de ses ouvriers, qui eux, manquaient de tout, était un monsieur honnête. Le député, le ministre dont les mains étaient toujours ouvertes aux pots-de-vin, étaient dévoués au bien public. L’officier qui expérimentait le fusil nouveau modèle sur des enfants de sept ans avait bien fait son devoir et, en plein Parlement, le président du Conseil lui administrait ses félicitations ! Tout ce que je vis me révolta, et mon esprit s’attacha à la critique de l’organisation sociale. Cette critique a été trop souvent faite pour que je la recommence. Il me suffira de dire que je devins l’ennemi d’une société que je jugeais criminelle.
Un moment attiré par le socialisme, je ne tardai pas à m’éloigner de ce parti. J’avais trop d’amour pour la liberté, trop de respect de l’initiative individuelle, trop de répugnance à l’incorporation pour prendre un numéro dans l’armée matriculée du quatrième Etat.
D’ailleurs je vis qu’au fond le socialisme ne change rien à l’ordre actuel. Il maintient le principe autoritaire, et ce principe, malgré ce qu’en peuvent dire de prétendus libres penseurs, n’est qu’un vieux reste de la foi en une puissance supérieure. Des études scientifiques m’avaient graduellement initié au jeu des forces naturelles. Or j’étais matérialiste et athée ; j’avais compris que l’hypothèse Dieu était écartée par la science moderne, qui n’en avait plus besoin. La morale religieuse et autoritaire, basée sur le faux, devait donc disparaitre. Quelle était alors la nouvelle morale en harmonie avec les lois de la nature qui devait régénérer le vieux monde et enfanter une humanité heureuse ?
C’est à ce moment que je fus mis en relation avec quelques compagnons anarchistes , qu’aujourd’hui je considère encore comme les meilleurs que j’ai connu. Le caractère de ces hommes me séduisit tout d’abord. J’appréciais en eux une grande sincérité, une franchise absolue, un mépris profond de tous les préjugés, et je voulus connaitre l’idée qui faisait des hommes si différents de tous ceux que j’avais vu jusque-là. Cette idée trouva en mon esprit un terrain tout préparé, par des observations et des réflexions personnelles, à la recevoir. Elle ne fit que préciser ce qu’il y avait encore chez moi de vague et de flottant. Je devins à mon tour anarchiste. Je n’ai pas à développer ici la théorie de l’anarchie. Je ne veux en retenir que le côté révolutionnaire, le côté destructeur et négatif pour lequel je comparais devant vous. En ce moment de lutte aigüe entre la bourgeoisie et ses ennemis, je suis presque tenté de dire avec le Souvarine de Germinal : « Tous les raisonnements sur l’avenir sont criminels, parce qu’ils empêchent la destruction pure et simple et entravent la marche de la révolution. »
Dès qu’une idée est mûre, qu’elle a trouvé sa formule, il faut sans plus tarder en trouver sa réalisation. J’étais convaincu que l’organisation actuelle était mauvaise, j’ai voulu lutter contre elle, afin de hâter sa disparition. J’ai apporté dans la lutte une haine profonde, chaque jour avivée par le spectacle révoltant de cette société, où tout est bas, tout est louche, tout est laid, où tout est une entrave à l’épanchement des passions humaines, aux tendances généreuses du cœur, au libre essor de la pensée. J’ai voulu frapper aussi fort et aussi juste que je le pouvais. Passons donc au premier attentat que j’ai commis, à l’explosion de la rue des Bons-Enfants.
J’avais suivi avec attention les évènements de Carmaux. Les premières nouvelles de la grève m’avaient comblé de joie : les mineurs paraissaient disposés à renoncer aux grèves pacifiques et inutiles, où le travailleur confiant attend patiemment que ses quelques francs triomphent des millions des compagnies. Ils semblaient entrés dans une voie de violence qui s’affirma résolument le 15 août 1892. Les bureaux et les bâtiments de la mine furent envahis par une foule lasse de souffrir sans se venger : justice allait être faite de l’ingénieur si haï de ses ouvriers, lorsque des timorés s’interposèrent. Quels étaient ces hommes ? Les mêmes qui font avorter tout les mouvements révolutionnaires, parce qu’ils craignent qu’une fois lancé le peuple n’obéisse plus à leurs voix, ceux qui poussent des milliers d’hommes à endurer des privations pendant des mois entiers, afin de battre la grosse caisse sur leurs souffrances et se créer une popularité qui leur permettra de décrocher un mandat – je veux dire les chefs socialistes- ces hommes, en effet, prirent la tête du mouvement gréviste. On vit tout à coup s’abattre sur le pays une nuée de messieurs beaux parleurs, qui se mirent à la disposition entière de la grève, organisèrent des souscriptions, firent des conférences, adressèrent des appels de fonds de tous les côtés. Les mineurs déposèrent toute initiative entre leurs mains. Ce qui arriva, on le sait. La grève s’éternisa, les mineurs firent une plus intime connaissance avec la faim, leur compagne habituelle ; ils mangèrent le petit fonds de réserve de leur syndicat et celui des autres corporations qui leur virent en aide, puis au bout de deux mois, l’oreille basse, ils retournèrent à leur fosse, plus misérables qu’auparavant. Il eût été si simple, dès le début, d’attaquer la compagnie dans son seul endroit sensible, l’argent ; de brûler le stock de charbon, de briser les machines d’extraction, de démolir les pompes d’épuisement. Certes, la compagnie eût capitulé bien vite. Mais les grands pontifes du socialisme n’admettent pas ces procédés là, qui sont des procédés anarchistes. A ce jeu il y a de la prison à risquer, et, qui sait, peut être une de ces balles qui firent merveille à Fourmies. On y gagne aucun siège municipal ou législatif. Bref, l’ordre un instant troublé régna de nouveau à Carmaux. La compagnie, plus puissante que jamais, continua son exploitation et messieurs les actionnaires se félicitèrent de l’heureuse issue de la grève. Allons, les dividendes seraient encore bons à toucher.
C’est alors que je me suis décidé à mêler, à ce concert d’heureux accents une voix que les bourgeois avaient déjà entendue, mais qu’ils croyaient morte avec Ravachol : celle de la dynamite. J’ai voulu montrer à la bourgeoisie que désormais il n’y aurait plus pour elle de joies complètes, que ses triomphes insolents seraient troublés, que son veau d’or tremblerait violemment sur son piédestal, jusqu’à la secousse définitive qui le jetterait bas dans la frange et le sang. En même temps j’ai voulu faire comprendre aux mineurs qu’il n’y a qu’une seule catégorie d’hommes, les anarchistes, qui ressentent sincèrement leurs souffrances et qui sont prêts à les venger. Ces hommes là ne siègent pas au Parlement, comme messieurs Guesde et consorts, mais ils marchent à la guillotine. Je préparais donc une marmite. Un moment, l’accusation que l’on avait lancée à Ravachol me revint en mémoire. Et les victimes innocentes ? Mais je résolus bien vite la question. La maison où se trouvait les bureaux de la compagnie de Carmaux n’était habitée que par des bourgeois. Il n’y aurait donc pas de victimes innocentes. La bourgeoisie, tout entière, vit de l’exploitation des malheureux, elle doit toute entière expier ses crimes. Aussi, c’est avec la certitude absolue de la légitimité de mon acte que je déposais la marmite devant la porte des bureaux de la société. J’ai expliqué, au cours des débats, comment j’espérais, au cas où mon engin serait découvert avant son explosion, qu’il éclaterait au commissariat de police, atteignant toujours ainsi mes ennemis. Voilà donc les mobiles qui m’ont fait commettre le premier attentat que l’on me reproche.
Passons au second, celui du café Terminus. J’étais venu à Paris lors de l’affaire Vaillant. J’avais assisté à la répression formidable qui suivit l’attentat du Palais-Bourbon. Je fus témoin des mesures draconiennes prises par le gouvernement contre les anarchistes. De tous côté on espionnait, on perquisitionnait, on arrêtait. Au hasard des rafles, une foule d’individus était arrachée à leur famille et jetés en prison. Que devenaient les femmes et les enfants de ces camarades pendant leur incarcération ? Nul ne s’en occupait. L’anarchiste n’était plus un homme, c’était une bête fauve que l’on traquait de toutes parts et dont toute la presse bourgeoise, esclave vile de la force, demandait sur tous les tons l’extermination. En même temps, les journaux et les brochures libertaires étaient saisis, le droit de réunion était prohibé. Mieux que cela : lorsqu’on voulait se débarrasser complètement d’un compagnon, un mouchard déposait le soir dans sa chambre un paquet contenant du tanin, disait-il, et le lendemain une perquisition avait lieu, d’après un ordre daté de l’avant-veille. On trouvait une boite pleine de poudres suspectes, le camarade passait en jugement et récoltait 3 ans de prison. Demandez donc si cela n’est pas vrai au misérable indicateur qui s’introduisit chez le compagnon Mérigeault ? Mais tous ces procédés étaient bons. Ils frappaient un ennemi dont on avait eu peur, et ceux qui avaient tremblé voulaient se montrer courageux. Comme couronnement à cette croisade contre les hérétiques, n’entendit-on pas M. Raynal, ministre de l’Intérieur, déclarer à la tribune de la Chambre que les mesures prises par le gouvernement avaient eu un bon résultat, qu’elles avaient jeté la terreur dans le camp anarchiste. Ce n’était pas encore assez. On avait condamné à mort un homme qui n’avait tué personne, il fallait paraître courageux jusqu’au bout : on le guillotine un beau matin. Mais, messieurs les bourgeois, vous aviez un peu trop compté sans votre hôte. Vous aviez arrêté des centaines d’individus, vous aviez violé bien des domiciles ; mais il y avait encore hors de vos prisons des hommes que vous ignoriez, qui, dans l’ombre, assistaient à votre chasse à l’anarchiste et qui n’attendaient que le bon moment pour, à leur tour, chasser les chasseurs. Les paroles de M. Raynal étaient un défi jeté aux anarchistes. Le gant a été relevé. La bombe du café Terminus est la réponse à toutes vos violations de la liberté, à vos arrestations, à vos perquisitions, à vos lois sur la presse, à vos expulsions en masse d’étrangers, à vos guillotinades. Mais pourquoi, direz-vous, aller s’attaquer à des consommateurs paisibles, qui écoutent de la musique et qui, peut-être, ne sont ni magistrats, ni députés, ni fonctionnaires ? Pourquoi ? C’est bien simple. La bourgeoisie n’a fait qu’un bloc des anarchistes. Un seul homme, Vaillant, avait lancé une bombe ; les neuf dixième des compagnons ne le connaissaient même pas. Cela n’y fit rien. On persécuta en masse. Tout ce qui avait quelque relation anarchiste fut traqué. Eh bien ! Puisque vous rendez ainsi tout un parti responsable des actes d’un seul homme, et que vous frappez en bloc, nous aussi, nous frappons en bloc. Devons-nous seulement nous attaquer aux députés qui font les lois contre nous, aux magistrats qui appliquent ces lois, aux policiers qui nous arrêtent ? Je ne pense pas. Tous les hommes ne sont que des instruments n’agissant pas en leur propre nom, leurs fonctions ont été instituées par la bourgeoisie pour sa défense ; ils ne sont pas plus coupables que les autres. Les bons bourgeois qui, sans être revêtus d’aucunes fonctions, touchent cependant les coupons de leurs obligations, qui vivent oisifs des bénéfices produits par le travail des ouvriers, ceux-là aussi doivent avoir leur part de représailles. Et non seulement eux, mais encore tous ceux qui sont satisfaits de l’ordre actuel, qui applaudissent aux actes du gouvernement et se font ses complices, ces employés à 300 et à 500 francs par mois qui haïssent le peuple plus encore que le gros bourgeois, cette masse bête et prétentieuse qui se range toujours du côté du plus fort, clientèle ordinaire du Terminus et autres grands cafés. Voilà pourquoi j’ai frappé dans le tas, sans choisir mes victimes. Il faut que la bourgeoisie comprenne que ceux qui ont souffert sont enfin las de leurs souffrances ; ils montrent les dents et frappent d’autant plus brutalement qu’on a été brutal avec eux. Ce n’est pas aux assassins qui ont fait la semaine sanglante et Fourmies de traiter les autres d’assassins. Ils n’épargnent ni femmes ni enfants bourgeois, parce que les femmes et les enfants de ceux qu’ils aiment ne sont pas épargnés non plus. Ne sont-ce pas des victimes innocentes que ces enfants qui, dans les faubourgs, se meurent lentement d’anémie, parce que le pain est rare à la maison ; ces femmes qui dans vos ateliers pâlissent et s’épuisent pour gagner quarante sous par jour, heureuses encore quand la misère ne les force pas à se prostituer ; ces vieillards dont vous avez fait des machines à produire toute leur vie, et que vous jetez à la voirie et à l’hôpital quand leurs forces sont exténuées ? Ayez au moins le courage de vos crimes, messieurs les bourgeois , et convenez que nos représailles sont grandement légitimes.
Certes, je ne m’illusionne pas. Je sais que mes actes ne seront pas encore bien compris des foules insuffisamment préparées. Même parmi les ouvriers, pour lesquels j’ai lutté, beaucoup, égarés par vos journaux, me croient leur ennemi. Mais cela m’importe peu. Je ne me soucie du jugement de personne. Je n’ignore pas non plus qu’il existe des individus se disant Anarchistes qui s’empressent de réprouver toute solidarité avec les propagandistes par le fait. Ils essayent d’établir une distinction subtile entre les théoriciens et les terroristes. Trop lâches pour risquer leur vie, ils renient ceux qui agissent. Mais l’influence qu’ils prétendent avoir sur le mouvement révolutionnaire est nulle. Aujourd’hui, le champ est à l’action, sans faiblesse, et sans reculade. Alexandre Herzen, le révolutionnaire russe, l’a dit : « De deux choses l’une, ou justicier et marcher en avant ou gracier et trébucher à moitié route. » Nous ne voulons ni gracier ni trébucher, et nous marcherons toujours en avant jusqu’à ce que la révolution, but de nos efforts, vienne enfin couronner notre œuvre en faisant le monde libre. Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclaré à la bourgeoisie, nous ne demandons aucune pitié. Nous donnons la mort, nous saurons la subir. Aussi, c’est avec indifférence que j’attends votre verdict. Je sais que ma tête n’est pas la dernière que vous couperez ; d’autres tomberont encore, car les meurt-de-faim commencent à connaître le chemin de vos grands cafés et de vos grands restaurants Terminus et Foyot. Vous ajouterez d’autres noms à la liste sanglante de nos morts. Vous avez pendu à Chicago, décapité en Allemagne, garroté à Jerez, fusillé à Barcelone, guillotiné à Montbrison et à Paris, mais ce que vous ne pourrez jamais détruire, c’est l’anarchie. Ses racines sont trop profondes ; elle est née au sein d’une société pourrie qui se disloque, elle est une réaction violente contre l’ordre établi. Elle représente les aspirations qui viennent battre en brèche l’autorité actuelle, elle est partout, ce qui la rend insaisissable . Elle finira par vous tuer.
Voilà, messieurs les jurés, ce que j’avais à vous dire. Vous allez maintenant entendre mon avocat. Vos lois imposant à tout accusé un défenseur, ma famille a choisi Me Hornbostel. Mais ce qu’il pourra dire n’infirme en rien ce que j’ai dit. Mes déclarations sont l’expression exacte de ma pensée. Je m’y tiens intégralement. »