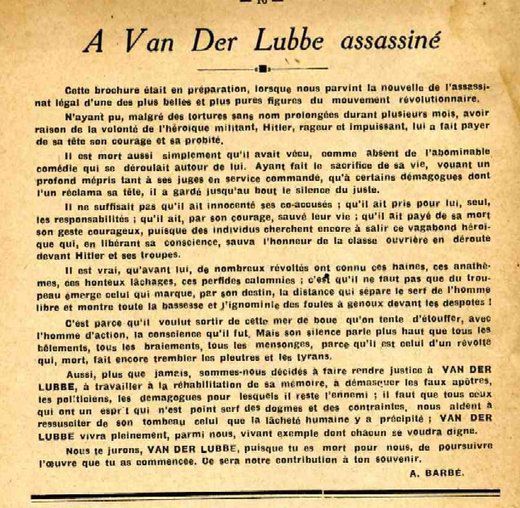Il y a tout juste un an, Hiroshima a été frappée par le malheur le plus épouvantable, le plus dramatique jamais expérimenté par l’humanité.
C’était le 6 août 1945, la vingtième année de l’ère Shôwa.
Il y a un an de cela. Au cours de cette année, c’est incroyable comme le monde a pu changer et s’agiter.
Avec cette bombe atomique, le grand Japon a tremblé sur ses bases avant de s’effondrer. Un pays de première grandeur au monde a été placé sous la botte de la huitième armée des États-Unis. Le support que jusqu’alors nous considérions avec confiance comme une base solide était si fragile qu’il s’est brisé d’un seul coup. Le Japon, pays de nos ancêtres dont nous sommes si fiers, le Japon dont il n’existe aucun pays comparable au monde, a perdu le combat.
Cela nous a laissés un moment stupéfaits, ne sachant que faire. Et il nous faut maintenant apprendre à vivre dans un misérable pays vaincu.
L’attitude de la population au retour des soldats de l’armée impériale, persuadés qu’ils sont restés fidèles jusqu’au bout à notre pays qui n’a aucun équivalent au monde pour la discipline et l’entraînement, a été d’une abomination égale à la confusion ambiante. Des actes délictueux ont commencé à menacer gravement la population.
L’étonnement quand j’ai découvert que « l’âme du Yamato » n’était que vaine illusion.
La pensée citoyenne a perdu son centre de gravité, la morale est tombée à terre. Et le malheur ne s’est pas limité à cela.
Les mauvaises récoltes de l’année dernière, suite aux dégâts causés par les tempêtes, sont venues plonger encore plus la société dans les ténèbres. L’apparition et la propagation du marché noir et des marchés aux voleurs qui menacent la vie économique de la population favorise l’apparition de parvenus enrichis par la défaite. L’égoïsme domine et la compassion est devenue plus fine qu’une feuille de papier. Cette qualité japonaise a disparu. Chacun a trop à faire pour survivre.
Actuellement le Japon est occupé par les États-Unis et des soldats de différents autres pays. Le pouvoir politique réel dépend du quartier général de Mac Arthur. Le Japon n’a toujours pas retrouvé sa souveraineté en tant que pays indépendant. Quel déshonneur national. Et il n’y a pas que cette humiliation. Concernant la morale et la discipline individuelles, nous devons apprendre tout un tas de choses des officiers de l’armée d’occupation. Le peuple japonais, qui a pu paraître trop arrogant, commence à douter de ses propres valeurs, il est devenu plus servile que nécessaire. Il est atrophié, physiquement et moralement. Tout le monde a beau crier à la reconstruction, on ne voit rien de concret en dehors des restaurants et des théâtres. On espère pour cette année une récolte abondante de riz, ce qui apaisera peut-être les esprits. Même si la lumière est loin d’être encore là. Les souffrances ne cessent de s’accroître. Mais je veux garder confiance en l’avenir. Quoi qu’il arrive, je ne veux pas perdre espoir.
Maintenant, en évoquant ce jour de la bombe atomique, je suis en proie à une violente émotion. Je vais essayer de décrire ce qui s’est passé tel que je m’en souviens.
.
Ce jour-là, le 6 août, tombait le premier lundi du mois. Le jour où l’électricité était coupée à l’aciérie Nihonseikô, l’endroit où nous, les élèves de première année, étions mobilisés pour le service civil ; nous quittâmes donc le foyer avec un plan pour la journée. Ceux, nombreux, qui vivaient en ville ou dans les environs allaient voir leurs familles, tandis que les autres qui habitaient trop loin sortaient en ville dans l’idée de se détendre, en allant par exemple au cinéma.
La rentrée s’était déroulée peu avant, le 1er août, et nos familles ne nous manquaient pas trop, mais nous étions si fiers d’être au lycée que, même si nous étions un peu désarçonnés par cette vie nouvelle, nous arrivions déjà à imiter les cris sauvages des élèves de deuxième année, et nous sommes partis pleins d’entrain, désireux de partager au plus vite notre joie avec nos proches.
Moi, ce jour-là, je franchis le portail du foyer avec deux de mes amis de collège, Yoshida et Ise. Sept heures du matin en été ce n’est pas trop tôt. Les plus matinaux d’entre nous étaient déjà sortis depuis longtemps, notre groupe était plutôt tardif. L’ardent soleil d’été tapait avec intensité sur l’asphalte et le ciel s’étendait, uniformément bleu. Les trains s’arrêtant à Hiroshima, nous prîmes le tramway place de la gare. Au moment de monter avec Ise dans celui qui allait à Koi, je vis Yoshida se poster dans une autre file pour monter dans celui qui arrivait. Je crois qu’il nous avait perdu de vue. En cours de route je me séparai également d’Ise pour changer à Tôkaichi, et quand j’arrivai à Yokogawa, il devait être environ huit heures quinze. La vente des billets n’avait pas encore commencé, une assez longue file s’était formée au guichet.
J’attendis un moment en me disant que dans ces conditions je ne trouverais sans doute pas de place assise, lorsque je remarquai quelques personnes qui avaient franchi le guichet et attendaient, n’ayant pu monter dans le train précédent. Parmi elles je repérai le calot à bande blanche des lycéens. C’était Ochiai. Rester là à attendre m’ennuyait. J’avais envie de le rejoindre pour discuter avec lui, alors j’eus une idée. Je n’avais qu’à passer par la gare. Je franchirais l’accès aux quais, et de là je passerais sur celui de la ligne de Kabe. C’était possible parce que j’avais ma carte d’abonnement. C’est ainsi qu’ayant pris place l’un à côté de l’autre dans le train qui arrivait juste à ce moment-là, nous passâmes le temps qui restait avant le départ à parler de la vie nouvelle que nous menions depuis quelques jours dans ce foyer, de notre étonnement, notre joie, de nos espoirs et nos impressions, et puis de notre profonde stupéfaction et de l’émotion ressentie lors de la cérémonie au cours de laquelle nous avions apposé notre signature et prêté serment.
Le départ était imminent lorsque le rideau se leva sur ce drame sanglant, inouï dans l’histoire de l’humanité. Hiroshima, ville maudite !
En un instant, les alentours s’éclairèrent au point que j’en fus aveuglé. En même temps qu’un grondement sourd montant de la terre, je sentis ma nuque brûler d’une douleur intense. Inconsciemment je me penchai vers l’avant tout en restant assis. La lumière n’en finissait pas de s’écouler. D’innombrables particules de lumière.
De tous côtés elles m’assaillaient. Des particules de lumière éblouissantes, dorées avec des reflets rouge. Des particules microscopiques, plus fines que de la poussière de feu. Par dizaines de milliers, par centaines de millions, elles se rejoignaient en une immense vague qui ne cessaient d’affluer. Un déluge de lumière, qui inondait la terre et déferlait à travers la vitre derrière moi. Je ne voyais rien. Le ciel et la terre coulaient en un scintillement rouge, jaune et or, où l’on distinguait des myriades de particules encore plus étincelantes. Pendant deux ou trois secondes peut-être ? Mais il me semble que cela a duré beaucoup plus longtemps. Et aussi pas plus d’un instant. C’était quoi ? Un accident ? pensai-je, et peu après la lumière disparut d’un coup, comme évaporée, tandis que tout était envahi de fumée noire. Après une telle explosion de lumière, quelle obscurité tout à coup ! Des ténèbres qui ne permettaient pas de voir à deux pas. Des cris de femmes. Les passagers se ruaient vers les portes. Je me suis jeté sur le quai où la fumée m’empêchait de voir. Soudain l’angoisse étreignit mon cœur. « Ah, c’est vrai, j’étais avec Ochiai ! » me rappelai-je et, brusquement soulagé, je criai de toutes mes forces « Ochiai ! » Alors un peu plus loin je l’entendis me répondre « Oh hé ! » « Où es-tu ? » « Ici ! » Je me mis à courir en me fiant à sa voix. Hors de moi, je courais éperdument, lorsqu’en franchissant les quais, mes sandales de paille s’envolèrent je ne sais où. Passant sous un gros pilier tombé en travers, je me cognai la tête et mon calot lui aussi s’envola, aspiré par les tourbillons de fumée. Mais je n’avais déjà plus la disponibilité d’esprit de me préoccuper de ces choses-là. Désespérément je criais « Ochiai ! Ochiai ! » en courant à toutes jambes. La fumée se dispersant, nous nous retrouvâmes tous les deux, Ochiai et moi, dans la rue du tramway. Les maisons alentour étaient aplaties, et au fur et à mesure que la fumée se dispersait on voyait plus loin. Les flammes commençaient à s’élever des décombres. J’avais l’impression de me retrouver dans un pays étranger. Non, en enfer, c’est plus exact. Je n’arrivais pas à comprendre que c’était réel. Nous restâmes un moment, hagards, n’en croyant pas nos yeux. Puis nous nous aperçûmes que nous ne pouvions pas rester là. « Mais que s’est-il passé ? » « Cette fois-ci c’est la fin ! » nous disions-nous, sans savoir s’il s’agissait d’une bombe explosive ou incendiaire. Les dégâts autour de nous faisaient penser qu’elle devait être assez grosse. En tout cas il s’agissait bien d’un bombardement ennemi. Même si l’on n’avait pas entendu de vrombissement dans le ciel. D’ailleurs, l’alerte venait tout juste d’être levée. De toute façon, en restant là nous serions pris dans l’incendie qui allait suivre. Je frémissais en me rappelant que pendant le grand bombardement de Tôkyô, le 10 mars, plusieurs dizaines de milliers de personnes prises dans les flammes avaient été brûlées vives. C’était un bombardement isolé. Le reste de la ville était certainement épargné. Yoshida habitait en ville. Ochifuji aussi. J’allais pouvoir faire soigner ma brûlure au cou. A cette pensée soudaine, je me crus sauvé et me mis à courir le long des rails du tramway. Ma nuque me lançait. En chemin je l’aspergeai plusieurs fois de l’eau des cuves de récupération. A la fin, n’en pouvant plus, j’y plongeais toute la tête. Je ne pensais pas que cela aurait un effet quelconque. Mais j’avais l’impression que cela pouvait me faire du bien.
Dans les rues, les gens couraient en tous sens. Les femmes et les enfants pleuraient et gémissaient. Ils avaient d’horribles brûlures au visage, on ne les reconnaissait pas. Une fillette de dernière année du primaire portait un petit enfant sur le dos et en tenait un autre par la main. « Papa ! Maman ! » criaient-ils en pleurant, fuyant dans la direction opposée à la nôtre, j’en ai gardé le souvenir. Les trois enfants étaient horriblement brûlés, du sang coulait sur leur visage. Une femme courait pieds nus, échevelée, sa robe de tissu léger noircie, la poitrine découverte. Visions insoutenables qu’en temps ordinaire il aurait été impossible de regarder en face. C’était l’enfer. Mais mon cœur était trop engourdi pour ressentir de la tristesse ou de la pitié à ce spectacle.
Soudain, d’une maison effondrée sur la gauche surgit une femme qui criait « Jeune homme, jeune homme ! » « Mon enfant est sous les décombres. Aidez-moi s’il vous plaît ! » Même si on voulait se dépêcher, on ne pouvait quand même pas l’ignorer, alors je la suivis. Une petite fille se débattait sur le sol, la tête prise sous un pilier. Elle était coincée et n’arrivait pas à se relever. « Maman ! Maman ! » criait-elle désespérément. « On va tout de suite te sortir de là, hein. Attends un peu, d’accord ? » disait sa mère, beaucoup plus calme et solide qu’on aurait pu le croire.
Je posai les mains sur le pilier pour essayer de le soulever mais des gravats s’entassaient dessus, il ne bougeait pas d’un pouce. Je me sentais nerveux et impatient. Je pensais que pendant ce temps-là nous étions encerclés par l’incendie et que nous ne pourrions pas y échapper ! Cela me donnait envie de tout laisser en plan et fuir. Le souvenir effrayant du tremblement de terre et du bombardement de Tôkyô, au cours desquels les gens sans refuge étaient morts d’une façon si cruelle, s’accompagnait maintenant d’une sensation bien réelle qui m’étreignait le cœur. Ou plutôt paralysait mes capacités à réfléchir. Mais en voyant cette malheureuse silhouette d’enfant, je ne pouvais pas tout laisser en plan et fuir. Soudain, Ochiai cria à côté de moi : « Partons ! Vite ! Si on traîne on va être pris par le feu ! » Je le vis me regarder avec irritation, prêt à s’enfuir. Je distinguai même une lueur de haine dans ses yeux, parce que je traînais.
Devant son regard terrible, je fus pris d’une brusque colère contre lui. Zut ! Sale égoïste ! Bon ! Moi je ne pars pas avant d’avoir sauvé l’enfant ! pensai-je, et du coup je me sentis raffermi. Ce n’était peut-être que l’énergie du désespoir. Je me forçai à reprendre le dessus sur mon chaos intérieur. Du calme ! Du calme ! Sois à la hauteur ! N’es-tu pas élève au lycée ? me répétais-je en cherchant autour de moi quelque chose qui pourrait me servir de levier. Je n’en trouvai pas. Mais je remarquai l’autre morceau du pilier brisé.
Je le pris aussitôt pour le glisser entre le sol et le reste du pilier qui entravait la tête de l’enfant. Avec le poids de tous ces gravats entassés dessus, je me demandais comment la tête de la petite fille n’avait pas été écrasée.
Une nuit, j’avais rêvé que je laissais tomber une grosse pierre sur la tête de ma petite sœur. Son crâne aussi mou que du plomb en était resté enfoncé. Me souvenant de ce rêve, je me sentis parcouru des mêmes frissons qu’alors. Je poussai de toutes mes forces sur le levier mais rien ne bougea. Pendant ce temps-là, la mère tira sur les jambes de sa fille, et je ne sais par quel miracle elle réussit à la sortir de là.
J’en fus soulagé, mais aussitôt la terreur des incendies me revint. Il ne fallait pas traîner. La mère parlait, mais je ne l’entendais pas. Avec Ochiai nous courûmes à perdre haleine vers le pont de Yokogawa. Là, le tramway qui avait déraillé était resté en l’état. Des éclats de vitres cassées étaient éparpillés partout. C’était douloureux de courir pieds nus dessus. On dit pourtant que si l’on est hors de soi on ne ressent pas la douleur… Autour de nous, les bâtiments écroulés comme après un tremblement de terre disparaissaient dans la fumée qui obscurcissait l’horizon. Au milieu de cette ombre crépusculaire, ici ou là se dressaient d’infernales flammes rougeoyantes. La ville était anéantie. C’était une réalité inimaginable. Mais c’était la réalité.
« On va remonter ce bras du fleuve » dit Ochiai.
Il coulait le long de Kawauchi. En le suivant vers l’amont nous étions sûrs d’arriver à l’embarcadère de Yaguchi. Les fermes où avaient été évacuées nos mères n’étaient pas loin de là. Remonter le fleuve était certainement ce qu’il y avait de mieux à faire.
Au pied du pont nous descendîmes sur la berge pour entrer dans l’eau. C’était marée basse, le niveau n’était pas trop haut. Avec nos vêtements et nos guêtres nous tentâmes de remonter le courant mais nous fûmes vite épuisés.
Impossible de le remonter à la nage. Faute de mieux nous décidâmes de longer la rive.
Nous reprîmes pied sur la berge pour traverser le pont et nous diriger vers la gare de Yokogawa. La route longeait le bras du fleuve. Il fallait quitter la ville au plus vite avant que le feu n’envahisse les chemins. J’étais sur les nerfs. Mais je me répétais intérieurement « Tu es un lycéen ! Tu es un lycéen ! » L’image d’un lycéen se confondait alors dans mon esprit à celle d’un jeune homme héroïque au caractère bien trempé. Un lycéen était un garçon courageux sortant du lot. Et je me détestais en lycéen prenant la fuite. Mais j’avais peur. Je ne voulais pas mourir. A une dizaine de kilomètres de là se trouvait mon cher foyer avec ma mère et ma jeune sœur. Autant dire à côté. Je ne me posai même pas la question de savoir si ma famille était en danger. Je voulais simplement rentrer à la maison, auprès de ma mère qui me manquait. Ce n’était pas loin, mais l’impatience à l’idée de ne pouvoir y arriver me rongeait d’une étrange angoisse mêlée de solitude. La route le long du fleuve était encombrée de gravats, piliers brisés, tôles tordues, tuiles cassées, et courir pieds nus dessus en sautant parmi les décombres était assez douloureux.
D’une maison effondrée sur ma gauche me parvinrent les cris d’un homme. « Au secours ! Au secours ! » Il devait se trouver coincé sous quelque chose. Il fallait le sortir de là au plus vite, sinon il mourrait brûlé vif ! Mais je n’avais déjà plus assez de disponibilité de cœur pour le faire. Malgré ma mauvaise conscience je n’eus pas un geste pour m’arrêter. Aujourd’hui encore à ce souvenir je suis tourmenté par un profond sentiment de culpabilité. J’éprouve du dégoût envers moi-même à l’idée que cette réaction donne une fausse image de moi.
Nous n’étions pas allés bien loin que déjà nous vîmes le feu qui avait tourné arriver face à nous. Sur notre gauche l’incendie se rapprochait inéluctablement. Sur notre droite il y avait la paroi rocheuse qui descendait vers la berge. Nous ne voulions pas rebrousser chemin. Si nous étions retournés sur nos pas, où aurions-nous pu nous réfugier ?
Mais enfin, qu’est-ce qui nous avait attaqués ainsi avec une telle violence ? Où était le centre de l’explosion ? Jusqu’où s’étendaient les dégâts ? Nous l’ignorions totalement. Depuis ce « pika » nous n’avions entendu aucun grondement d’avion, pas une seule explosion non plus. Au début je pensais qu’une bombe explosive ou incendiaire lâchée d’un avion ennemi volant à haute altitude était tombée par hasard sur la gare de Yokogawa… Mais partout, à perte de vue, ce n’étaient que ruines. Attaque aérienne, catastrophe naturelle, Il s’agissait sûrement d’un événement d’une ampleur inouïe, jusqu’alors inconnu.
Si nous traînions, cernés par l’incendie nous serions brûlés vifs. Ce devait être terriblement douloureux de mourir par le feu. L’épouvante me plongeait dans la confusion et je regardais autour de moi en me répétant « Du calme ! Du calme ! » La situation n’était peut-être pas encore complètement désespérée. Nous pourrions, en passant dessous, échapper au front de l’incendie qui arrivait sur nous. Il était nécessaire de quitter la ville au plus vite pour échapper aux flammes. En rassemblant notre courage pour franchir le feu nous pourrions peut-être nous retrouver à l’abri plus tôt que nous le pensions. Mais sur notre droite, un peu plus en amont et non loin de la berge, je découvris un bateau délabré assez grand. On apercevait dessus des silhouettes de gens qui avaient nagé jusqu’à lui pour échapper à l’incendie. Aussitôt mon cœur se raccrocha de toute ses forces à une nouvelle idée. « Attendons sur ce bateau que les flammes diminuent d’intensité. Quand l’incendie sera calmé, nous rentrerons à pied en longeant le fleuve. » Rien d’autre ne me venait à l’esprit. Des gens qui se noient s’agrippent même à un fétu de paille… Exactement comme dans le proverbe, je me raccrochais désespérément à l’idée de ce bateau délabré qui pouvait sombrer à tout moment. Je n’avais pas complètement perdu la raison. Au contraire, j’agissais même selon un jugement de loin beaucoup plus rationnel que mon comportement routinier du quotidien. Mais je ne pouvais échapper à l’agitation anormale de mes sentiments. C’est pourquoi mon jugement fut tout à fait partial. Tout se résumait à un rattachement instinctif à la vie. Peut-être même que la raison qui me poussait, au bord du désespoir, à me répéter « Du calme ! Du calme ! » n’était finalement rien de plus qu’un instinct de survie, pour échapper à la mort. Ochiai et moi plongeâmes dans le fleuve pour nager jusqu’au bateau. Le bastingage était haut, cela ne fut pas facile de s’y hisser. Les gens à bord étaient plus nombreux que je ne l’avais pensé. Une vingtaine ? La plupart atrocement brûlés ou blessés. Avec nos légères brûlures, nous éprouvions la curieuse envie de nous excuser auprès d’eux. Il y avait beaucoup de femmes et enfants en bas âge, mais dans ces moments-là, plus on est nombreux plus on se sent fort. Nous nous sommes enfin calmés un peu. Même si bien sûr l’angoisse à l’idée de ce qui allait advenir de nous, loin de disparaître, ne faisait qu’augmenter. Et nous étions aussi assez fatigués. En regardant vers la berge dont nous venions de sauter nous apercevions au bord de l’eau cinq ou six silhouettes qui descendaient de la route plus haut. Ces gens-là avaient-ils réussi à s’extraire des décombres de leur maison ? Ils n’avaient manifestement plus de forces car ils restaient accroupis sans bouger. Aah, mes pauvres, venez nous rejoindre, sinon vous allez mourir brûlés sous les escarbilles ! Maintenant que j’étais calmé je sentais monter en moi pour la première fois un peu de compassion humaine. Les flammes sur les rives progressaient à vue d’œil et les incendies qui avaient pris ici ou là s’étaient maintenant répandus en une mer de feu. Sous ces flammes, plusieurs centaines, plusieurs milliers de gens allaient-ils vraiment mourir ? Imaginant les souffrances de cet enfer, je fus pris d’une douleur intense qui me serra le cœur. Terrifié par ce destin effrayant qui nous menaçait, j’étais reconnaissant au désir que j’éprouvais d’y survivre. Le ciel était obscurci par la fumée. Le soleil flottait au milieu du ciel, boule de feu rouge sombre sans éclat, tel qu’à travers un morceau de verre noirci lors de l’observation d’une éclipse. C’était lugubre. Déplaçant mon regard au loin vers l’aval, dans une obscurité crépusculaire, je vis des flammes rouge vif envahir tout mon champ de vision. A en juger d’après la hauteur du soleil, il devait être à peine midi passé, mais il faisait aussi sombre que si la nuit tombait. Impossible de croire que cette scène appartenait au monde. Tout, du visage ensanglanté de la femme échevelée allongée sur le pont étroit, à la peau violette, brûlée et tuméfiée, de l’homme accroupi à la poupe, n’était qu’images infernales. Le feu s’intensifiait de plus en plus. Il investissait brusquement les maisons qui bordaient le fleuve, aussitôt détruites par les flammes. Les incendies provoquaient des tourbillons qui attisaient le feu encore plus. Les piliers et les poutres étaient emportés comme des feuilles d’arbres avant de retomber sur l’eau dans un jaillissement de vapeur. Des escarbilles tombaient sans discontinuer sur le bateau et à la surface de l’eau. De temps en temps arrivait un morceau de bois enflammé. Dans le grondement sourd du feu, il tombait à l’eau avec un chuintement strident. Lors du grand bombardement de Tôkyô, on disait que la Sumida charriait des cadavres. Les flammes couraient à la surface de l’eau et même ceux qui avaient plongé dans le fleuve mouraient brûlés vifs. J’avais également entendu parler du drame qui s’était déroulé sur le site du Hifukushô lors du grand tremblement de terre de Tôkyô, le 1er septembre 1923. Me rappelant ces récits, j’éprouvai une peur nouvelle. Alors que le feu s’intensifiait à vue d’œil sur la rive que nous venions de quitter, sur celle d’en face l’importance des flammes avait bien diminué. Sans doute que tout ce qui pouvait brûler avait fini par se consumer entièrement. La fumée noire empêchait de voir plus loin, mais l’incendie commençait à se calmer au moins en bordure du fleuve. Sur l’autre rive nous serions à l’abri, mais j’hésitais, n’ayant pas trop confiance en ma capacité à nager, si bien que nous restions sur ce bateau délabré.
Tout danger n’était pas encore écarté. La pluie de flammèches en provenance de la rive la plus proche tombait toujours. Le bateau pouvait s’embraser d’un instant à l’autre. Il y avait non loin de nous un groupe de trois femmes. Une mère d’un certain âge et ses deux jeunes filles. Heureusement aucune d’elles n’avait la moindre égratignure. Un peu plus tôt elles avaient étalé du baume sur nos brûlures. Les deux sœurs nous disaient tour à tour : « Jeune homme, fuyons ensemble ! » Nous ne savions comment préserver notre vie, alors comment aurions-nous pu nous soucier de celle des autres ? Si j’avais été plus calme, si j’avais été plus fort, j’aurais peut-être été capable de les aider. Finalement j’étais faible. Je ne pensais qu’à moi. Même si en temps ordinaire je fanfaronnais, il suffisait d’enlever l’écorce, à l’intérieur je n’étais rien de plus qu’un être faible et misérable. La faiblesse est laide. Dans certaines circonstances, les actes d’un être fort son si beaux ! Et dans un moment pareil, comme mon attitude égoïste était laide ! Chaque fois que le souvenir m’en revient j’éprouve une tristesse pleine d’indignation envers moi-même.
Bientôt ce fut la fin pour notre embarcation. Soudain l’eau déferla de la poupe. Le bateau s’inclina brusquement. Quelque chose qui jusqu’alors tenait à grand peine avait dû céder d’un seul coup. C’était déjà une épave délabrée qui pourrissait. Si elle sombrait c’était fini. Nous fûmes projetés à l’eau. Je me mis à nager vers l’autre rive, où le feu commençait à faiblir. J’étais incapable de me diriger vers la plus proche, où le feu crépitait toujours. Mais je manquais de confiance en moi pour nager jusque là-bas. Aux trois femmes qui nous accompagnaient j’avais seulement dit : « En allant sur la rive d’en face on sera sauvés ! » Je ne m’attendais pas à ce qu’elles puissent nager jusque-là, surtout la mère. Mais même si j’avais voulu les sauver, qu’aurais-je pu faire ? J’étais déjà suffisamment occupé de moi-même. C’était ma faiblesse, c’était ma laideur. A mi-parcours j’étais déjà épuisé. Mon corps fragilisé après l’opération d’une hernie n’avait pas encore vraiment récupéré. De plus la fatigue – physique et psychologique – était grande depuis le matin. Et même si j’étais en tenue d’été, avec la veste et les guêtres, mon corps était très lourd dans l’eau. En me retournant je vis que le bateau avait été englouti. Je distinguai deux ou trois têtes, noires au-dessus de l’eau. Qu’étaient devenues les trois femmes ? La silhouette de la mère allongée sur le pont me traversa l’esprit avant de disparaître.
« A l’aide, à l’aide ! » entendis-je crier.
Un homme seul avait nagé presque jusqu’au milieu du fleuve. A chaque brasse son torse se dressait à la surface de l’eau. Comment pouvait-il se comporter ainsi alors qu’il avait tant d’énergie !
Cela me mit en colère. Parce qu’il croyait que quelqu’un allait venir l’aider ? C’était bien inutile ! Une telle stupidité m’irritait encore plus.
Je commençais progressivement à sentir arriver le désespoir. Un désespoir dont nul n’aurait pu me sauver. Mes bras bougeaient de moins en moins et mes jambes étaient lourdes comme du plomb. Il y avait encore pas mal de distance jusqu’à la rive. Je me dis qu’en ne bougeant plus je pourrais au moins flotter, si bien que j’arrêtai de remuer bras et jambes. Aussitôt mon corps s’enfonça comme une pierre. Maintenant, avec la marée haute, le niveau de l’eau était à son maximum. Mes pieds n’en finissaient pas de toucher le fond et j’avais l’impression de m’enfoncer irrémédiablement. Dans un sursaut je me débattis et réussis à garder la tête hors de l’eau. Je me voyais mourir. Alors que j’avais échappé au feu, mourir maintenant c’était tellement pitoyable ! Je ne voulais pas mourir. Plus que la mort en soi, ce sont les souffrances d’avant la mort que l’homme craint le plus, me disais-je avec une sensation bien réelle. C’était certainement très douloureux de se noyer. Dans les livres il était écrit qu’alors on voyait souvent défiler des souvenirs fantomatiques du passé ou de proches. Mais moi je ne vis rien de tout cela. Je ne voyais que le ciel noir, l’eau noire et les flammes rouges comme des démons. Mon attachement à la vie fit sans doute que je n’abandonnai pas tout espoir. Je m’efforçais d’évoquer la présence de ma mère et mes sœurs. Soudain, en regardant sur le côté, je vis devant moi une des jeunes filles du bateau qui, accrochée à une planche, allait dans le même sens à la nage. C’était la plus jeune. Quand on se noie on se raccroche même à un fétu de paille… Oubliant toute honte je m’approchai d’elle. « Excusez-moi, mais pourriez-vous m’aider ? » lui demandai-je en haletant et, tendant le bras de toutes mes forces j’attrapai le bord de la planche. Sans même penser qu’en m’agrippant à un morceau de bois aussi petit, je risquais de l’entraîner dans la noyade. Mais, et ce fut une surprise, elle tenait deux planches. Elle m’en donna une. Je la glissai sous mon ventre et pour la première fois je pensai : « Je suis sauvé ! » C’était une petite planche peu épaisse d’à peine un mètre de long, mais je n’avais plus besoin d’agiter sans arrêt bras et jambes pour ne pas m’enfoncer. Le destin me jouait un bien mauvais tour : il me faisait secourir par la jeune fille que j’avais abandonnée un peu plus tôt. Et en plus, avant d’en ressentir de la honte, j’étais heureux d’être sauvé.
J’étais effrayé par la force ignoble qui me rattachait à la vie.
Le fleuve était bordé d’un imposant mur de pierre et il y avait des marches. Arrivé en haut, je me retrouvai derrière le sanctuaire de Gokoku et l’hôpital militaire. Au sommet du mur s’étendait un terrain vague au-delà duquel une digue peu élevée longeait le fleuve. Je pensai que là nous serions en sécurité. Et mes forces soudain me quittèrent. Ce terrain vague d’une dizaine de mètres de large entre le mur et la digue se poursuivait vers l’aval. Je me dirigeai vers l’amont au milieu des broussailles qui fumaient encore ici ou là.
La jeune fille me suivait en me demandant « Jeune homme, emmenez-moi avec vous ! » Elle devait se sentir abandonnée car elle parlait avec des sanglots dans la voix. « Tout va bien maintenant, venez. » J’avais plus de disponibilité de cœur et j’étais calme. Un peu plus loin on voyait se déplacer médecins, infirmières et soldats malades ou blessés. Les soldats restés à l’intérieur du bâtiment étaient morts brûlés sous les décombres. Les autres avaient survécu parce qu’ils se trouvaient par hasard dehors et protégés par quelque chose. Ils avaient eu de la chance. Sur ce terrain vague ils avaient rassemblé vivres, matériel de soin, médicaments, lits et vêtements. Un tonnelet de prunes confites et un sac de farine brûlaient. Les soldats allaient puiser de l’eau dans le fleuve pour la verser dessus. Le feu du tonnelet s’éteignit aussitôt, mais la farine était rouge et ils avaient beau l’arroser elle continuait à se consumer. Ochiai arriva à la nage. Une ou deux autres personnes remontaient sur la berge en rampant. Nous nous réconfortâmes l’un l’autre en nous réjouissant.
Où donc étaient passés les gens si nombreux sur le bateau ? La jeune fille arrivée ici commençait sans doute à se relâcher. Elle éclata soudain en sanglots en criant : « Maman ! Maman ! » Elle avait à peu près mon âge. Sa mère et sa sœur aînée avaient sans doute été entraînées par le courant. Un autre garçon avait réussi à nager depuis le bateau. Il nous dit qu’il était élève de première année au lycée technique départemental. Il avait une terrible blessure au-dessus de l’œil gauche. Un pilier lui était tombé dessus. Sa sœur cadette avait été ensevelie sous les décombres de leur maison. Sa mère avait dû être emportée quand le bateau avait coulé. Il racontait tout cela sans la moindre émotion sur le visage. La blessure de son cœur était trop importante, il était hébété et paraissait ne pas croire qu’il était sauf.
Soudain une vilaine pluie se mit à tomber. Nous nous réfugiâmes dans l’abri antiaérien aménagé le long de la digue. Nous étions trempés jusqu’aux os, c’était très désagréable, aussi nous empruntâmes les vêtements de l’hôpital pour nous changer. La pluie s’arrêta vite, comme une averse. Les incendies avaient sans doute passablement faibli car la fumée se dissipait peu à peu. Le soir approchait. L’infirmière étala sur mon cou de la pommade pour les brûlures. Comme je l’avais plongé plusieurs fois dans de l’eau stagnante il me cuisait douloureusement. Le médecin militaire avait décidé d’établir un centre de secours sur ce terrain vague. Il nous demanda d’aider à construire des abris avec des lits placés verticalement auxquels nous accrochions des toiles de tente. Ensuite, avec du bambou et de la toile, nous fabriquâmes des brancards destinés à ramasser les blessés tombés un peu partout. Nous n’avions fait que fuir en tous sens depuis le matin, aussi notre fatigue physique et psychologique était-elle importante. Les éclats de verre enfoncés dans mes pieds m’élançaient à chaque pas. Et les blessés à l’agonie étaient affreusement lourds. Après en avoir transporté deux ou trois, nous étions rompus. Le centre d’hébergement se remplissait de blessés. Les visages gonflés et violacés étaient méconnaissables. Les cheveux grillés et tire- bouchonnés, les lèvres boursouflées à un point tel que la distinction entre homme et femme devenait impossible. C’étaient des silhouettes dont ordinairement nous n’aurions pas supporté la vue. Je reconnus une nouvelle fois la chance que mon corps avait eue.
Entre vingt et trente personnes avaient été recueillies. L’infirmière travaillait avec empressement. Une femme solide qui devait avoir aux alentours de trente ans.
Elle était infirmière en chef. Deux ou trois soldats revinrent d’une sortie, indemnes. Ils étaient accompagnés d’une jeune fille. Qui se précipita vers elle en criant « Madame l’infirmière en chef ! » avant de se mettre à pleurer à gros sanglots. Elle la réconforta et essaya de lui redonner courage.
L’hôpital de l’autre côté de la digue s’était effondré et avait entièrement brûlé, seule une grosse cheminée se dressait intacte. Entre les éboulis je vis deux cadavres brûlés, entièrement noirs. Carbonisés au point qu’ils n’avaient plus forme humaine : ils avaient roulé sur le sol comme de grosses racines calcinées. Depuis le matin mon cœur avait eu le temps de s’habituer à ces tragiques silhouettes humaines. Mais à la vue de ces cadavres, ma poitrine se serra douloureusement, de peur et de compassion. Bientôt ce fut la nuit. Les décombres brûlaient encore un peu partout, et dans le ciel noir les flammes rougeoyaient de façon effrayante. Nous mangeâmes du riz et du miso entreposés dans l’abri antiaérien.
Comme je n’avais rien pris depuis le matin, ce repas me sembla terriblement bon.
Les soins aux blessés ayant été dispensés, ceux qui allaient bien se rassemblèrent pour raconter la terrible expérience vécue depuis le matin.
Personne ne connaissait la cause de ce désastre. « Pendant la nuit des avions ennemis ont arrosé Hiroshima d’essence. L’essence s’est mélangée à l’air, ils sont revenus ce matin mettre le feu. C’est parce que tout a explosé d’un coup que les gens sont blessés de cette manière épouvantable », expliquaient certains comme s’ils avaient été témoins de la scène. Et ces explications fantaisistes, nous les écoutions maintenant comme si elles étaient vraisemblables. Les ravages étaient extraordinairement importants. Personne n’avait idée de jusqu’où ils s’étendaient. En écoutant toutes ces histoires je commençai à m’inquiéter pour ma famille. Le village où elle était réfugiée se situait à une dizaine de kilomètres. Jusqu’alors je n’avais même pas pensé qu’il pouvait avoir été détruit. Mais le cœur humain a tendance à dramatiser. Maintenant que j’avais commencé à m’inquiéter j’imaginais le pire. Heureusement le feu s’était calmé. Ochiai et moi nous parlâmes au médecin militaire de notre intention de rentrer à la maison. Mais pour l’heure, là où nous nous trouvions, c’était lui qui dirigeait. Aussitôt il nous cria dessus : « Vous voyez que nous sommes ennuyés parce que nous manquons de bras et vous, deux jeunes gens en bonne santé, vous voulez nous abandonner pour rentrer chez vous ! » En effet, vu sous cet angle, il n’avait pas tort.
Mais il y avait dans l’attitude de ce médecin quelque chose d’antipathique. Les soldats à proximité en furent également pour leurs frais.
A partir de là nous restâmes silencieux. Nous étions tous sur les nerfs. Dans le ciel nocturne volait un B-29 solitaire. « Ils ne vont pas en larguer d’autres, quand même ! » s’est inquiété quelqu’un. C’est idiot ! N’importe quel imbécile peut comprendre qu’on ne larguerait pas des bombes sur de pareilles ruines ! pensai-je en trouvant cela ridicule. Différents quartiers de la ville brûlaient encore ici ou là. En projetant des escarbilles qui faisaient rougeoyer le ciel.
Les yeux rivés sur les flammes, je voyais toutes sortes d’images fantastiques. Qui se détachaient et disparaissaient d’une manière décousue, comme si j’oubliais tout ce qu’il y avait avant et après. Cette peur depuis le matin et cette activité incessante nous avaient épuisés corps et âme. Nos mères devaient se faire tellement d’inquiétude. Et peut-être que chez nous aussi il y avait des dégâts ? A la campagne, en cas d’incendie on trouvait facilement où se réfugier. Si l’on n’était pas blessé… Mes pensées n’en finissaient pas de tourner en rond.
Il fallait absolument nous mettre en route dès le matin.
Enroulés dans une couverture nous étions couchés sur le sol. Ce fut ma première nuit à la belle étoile. J’ai pensé que c’était possible parce que nous étions en été.
Le ciel comme d’habitude était magnifiquement étoilé.
Quand j’ouvris les yeux le lendemain matin mon corps n’allait pas bien. Même si c’était normal d’avoir des courbatures, mes pieds criblés d’éclats de verre, surtout le droit, étaient douloureux et me gênaient. Je n’arrivais à marcher que très doucement en boitant et en traînant la jambe. Je n’avais pas du tout d’appétit. J’étais abattu comme si j’avais une forte fièvre. Le médecin ne voulait pas nous lâcher jusqu’à ce qu’il ait reçu du renfort, disait-il. La douleur de mes pieds allait en augmentant. Marcher me devenait de plus en plus difficile. En continuant ainsi je n’allais bientôt plus pouvoir me déplacer, et cela m’inquiétait. Je restais immobile sans rien faire et le médecin, plein de colère, cria : « Voyez-moi ces jeunes gens ! Des garçons sans volonté ! »
Je sentais son regard plein d’animosité sur mon profil mais j’avais décidé de l’ignorer. Ce matin-là quelques blessés arrivèrent qu’il était impossible d’abriter sous les tentes de fortune et que l’on fit s’allonger dehors. Les infirmières et les soldats leur dispensaient des soins. Nous les aidions mais j’avais l’impression que si je bougeais trop je serais incapable de me déplacer plus tard, et craignant de devoir renoncer à rentrer chez moi, je finis par m’asseoir et ne plus bouger.
Sur ces entrefaites, une dizaine de soldats en bonne santé arrivèrent, qui saluèrent le médecin militaire. Ils venaient sans doute en renfort de l’hôpital de Mitaki. Nous n’avions donc plus rien à faire ici. C’est ce que nous pensions, alors Ochiai, le garçon du lycée technique et moi, nous partîmes en traversant le pont de Misasa. Nous étions persuadés que le médecin nous dirait encore des choses désagréables, c’est pourquoi nous lui faussâmes discrètement compagnie.
Sur le pont, un homme était mort penché sur le parapet. La couleur de la peau de son dos dénudé, tourné vers nous, était marron.
Tout ce qui pouvait brûler en ville avait brûlé, et l’on ne voyait plus de flammes nulle part, mais cela fumait encore beaucoup. Derrière les décombres des maisons incendiées, la vue était dégagée, et les montagnes aux lointains paraissaient toute proches. Sous les rayons ardents de l’impitoyable soleil d’août je ramassai en chemin un bambou vert qui me servit de canne et me traînai lourdement. Mes pieds soulevaient une poussière blanchâtre. J’avais l’impression de marcher sans avancer. Les gens que nous croisions s’adressaient à nous comme à de vieilles connaissances avant de continuer leur chemin. « Comme c’est terrible ! Soyons courageux jusqu’à la victoire ! » nous exhortaient même certains en passant.
En cours de route nous rencontrâmes Kawashima, le professeur de notre troupe. Il nous raconta d’un air sombre qu’il avait perdu son fils, en première année lui aussi. Au moment du bombardement, lui-même se trouvait non loin du départ de la ligne du tramway et il en avait réchappé de justesse.
La ligne de Kabe fonctionnait entre Nagatsuka et Kabe. Nous montâmes dans le train à Nagatsuka et descendîmes au pont de Furuichi où Ochiai et moi nous séparâmes.
Furuichi n’avait pas subi de gros dégâts, seules les vitres des maisons étaient brisées. Il n’y avait pas de problème chez moi ! Ils étaient tous sains et saufs ! pensai-je avec joie. Je venais de traverser le pont de Kanda, qui à la limite de la ville donne accès à Kawauchi lorsque, ne pouvant plus avancer, je me suis assis près d’un bâtiment où se rassemblaient différents groupes de défense passive. Adossé à la pile du pont, je fus soudain assailli par une irrépressible envie de dormir et ne pus m’empêcher de fermer les yeux. J’avais l’impression de m’enfoncer à toute vitesse dans le sommeil. Je pensais bien qu’il ne fallait pas m’endormir, mais je n’arrivais pas à garder les yeux ouverts. A l’idée que si je me laissais aller je n’arriverais jamais à rentrer chez moi, j’essayai de rassembler mes dernières forces pour me lever et me remettre en marche, lorsque j’entendis une voix féminine. « Ne seriez-vous pas le jeune Tôhara ? » C’était la fille des Tsuneda, les fermiers chez qui nous étions réfugiés. Elle demanda à un homme qui justement passait sur sa bicyclette de me ramener chez eux. L’homme habitait Kawauchi.
Quand j’arrivai à la maison, ma sœur cadette, surprise, sortit précipitamment. Il s’avéra que ma mère, inquiète pour moi, était partie aux nouvelles avec ma tante chez les Ochiai à Yasu. Je demandai à ma sœur de m’étendre un couchage et plongeai aussitôt dans le sommeil.
Ayant l’impression que quelqu’un m’appelait j’ouvris soudain les yeux et vis ma mère pleurer à mon chevet. Lorsqu’elle était arrivée chez les Ochiai, mon ami n’était pas encore rentré. Sa mère elle aussi était inquiète. La mienne s’était rendue chez Yûdô, un autre élève du lycée de Hiroshima, qui était chez lui avec une brûlure au visage, mais allait bien. Me croyant mort, elle était revenue en larmes, me dit-elle.
En me découvrant vivant, ses larmes de tristesse se transformèrent aussitôt en larmes de joie. Je l’entendis vaguement me raconter cela. J’eus ensuite une forte fièvre, ce qui m’obligea à rester couché pendant un certain temps. Ma brûlure qui suppurait n’en finissait pas de cicatriser.
J’étais encore allongé lors de l’entrée en guerre de la Russie. J’en ressentis une indignation sans bornes. Je fus d’humeur tragique toute la journée.
Le 15 août, je mangeais des boulettes de pâte de riz préparées par ma mère lorsque fut diffusée la déclaration impériale.
Sur l’enregistrement, la voix de l’empereur était recouverte par les parasites, de sorte qu’on ne saisissait pas très bien ses paroles. Sans bien comprendre ce qui se passait, ma mère et ma tante versaient des larmes.
Aussitôt après, un présentateur répéta la déclaration, je compris alors qu’il s’agissait de la défaite. Sur le moment, il ne parla pas de défaite, mais d’acceptation de la déclaration de Potsdam. « Pourquoi Sa majesté ne demande-t-elle pas à son peuple de se battre jusqu’à la mort ? » s’exclama ma mère avec dépit. « Si on a perdu, tant mieux, les B… ne viendront plus ! » entendit-on crier le père Tsuneda en bas. Sa voix débordait d’un soulagement bien réel. La brutalité de son franc-parler me mit en colère, mais moi-même je ne peux me défendre d’avoir éprouvé un réel soulagement.
.
Une bombe semblable à celle de Hiroshima fut également larguée sur Nagasaki. On apprit qu’il s’agissait de bombes atomiques. Je suis toujours aussi étonné de la puissance de cette énergie. Les rues de Hiroshima furent presque toutes réduites à néant. Près de cent mille personnes en sont mortes. Et la puissance destructrice de la bombe atomique ne se limita pas à son explosion. Il y eut une épidémie d’une étrange maladie appelée syndrome de la bombe atomique. Un syndrome accompagné de divers symptômes.
Au début les gens mouraient après avoir vomi ou évacué des caillots de sang noir. Plus tard les cheveux tombaient, des taches violettes apparaissaient sur la peau, on s’affaiblissait progressivement et on finissait par mourir. C’est ainsi qu’ont disparu beaucoup de gens sortis miraculeusement indemnes de l’explosion. La fille aînée des Tsuneda mourut de cette façon quelque temps plus tard, alors qu’elle était revenue chez elle sans blessure apparente. Ceux qui perdaient leurs cheveux étaient abandonnés même des médecins. J’ai vécu en tirant chaque matin sur mes cheveux pour me convaincre que je tenais encore le coup.
Longtemps après a été publiée dans les journaux la photographie du panache de fumée en forme de champignon si particulier aux explosions atomiques. Et l’Amérique a continué ses explosions expérimentales sur les fonds marins de l’atoll de Bikini.
Un an après, Hiroshima est en train de renaître, alors qu’il a été dit à tort qu’aucun être vivant ne pourrait y habiter pendant soixante-quinze ans.
Aujourd’hui encore, les habitants désignent la bombe atomique sous le petit nom affectueux de « Pikadon » [1].
Hisashi Tôhara, 1946.

 Aujourd’hui, mardi 28 août 2018, des expulsions partielles ont eu lieu dans le campement de la prairie à coté de la Forêt de Hambach, à la suite d’une perquisition ayant pour but d’obtenir des preuves concernant des actions passées et de saisir des objets pouvant servir à mener d’autres actions dans le futur.
Aujourd’hui, mardi 28 août 2018, des expulsions partielles ont eu lieu dans le campement de la prairie à coté de la Forêt de Hambach, à la suite d’une perquisition ayant pour but d’obtenir des preuves concernant des actions passées et de saisir des objets pouvant servir à mener d’autres actions dans le futur. Ce même jour, 28 août 2018, l’entreprise énergétique en charge du projet de mine RWE POWER AG a détourné les réserves d’eau IBC* afin de priver d’eau les occupant-e-s en prétextant le fait que la zone ait été décrétée « dangereuse ». Ces réserves d’eau de 1000 litres sont bien sûr nécessaires pour faire vivre l’occupation.
Ce même jour, 28 août 2018, l’entreprise énergétique en charge du projet de mine RWE POWER AG a détourné les réserves d’eau IBC* afin de priver d’eau les occupant-e-s en prétextant le fait que la zone ait été décrétée « dangereuse ». Ces réserves d’eau de 1000 litres sont bien sûr nécessaires pour faire vivre l’occupation.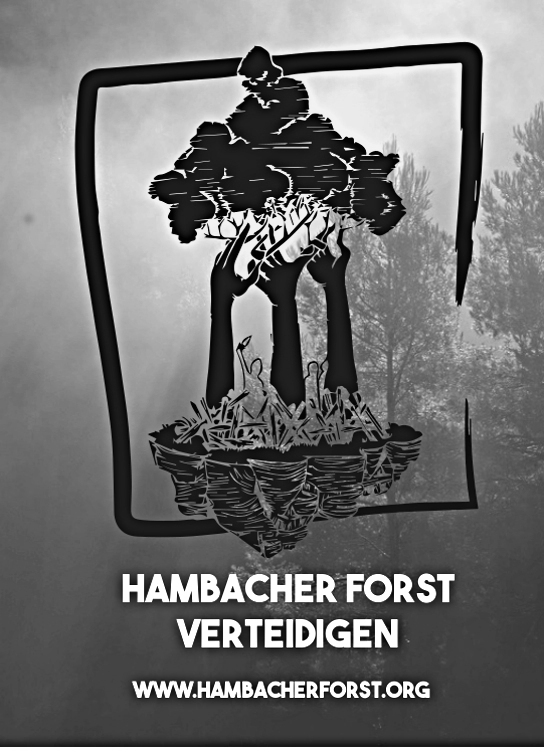


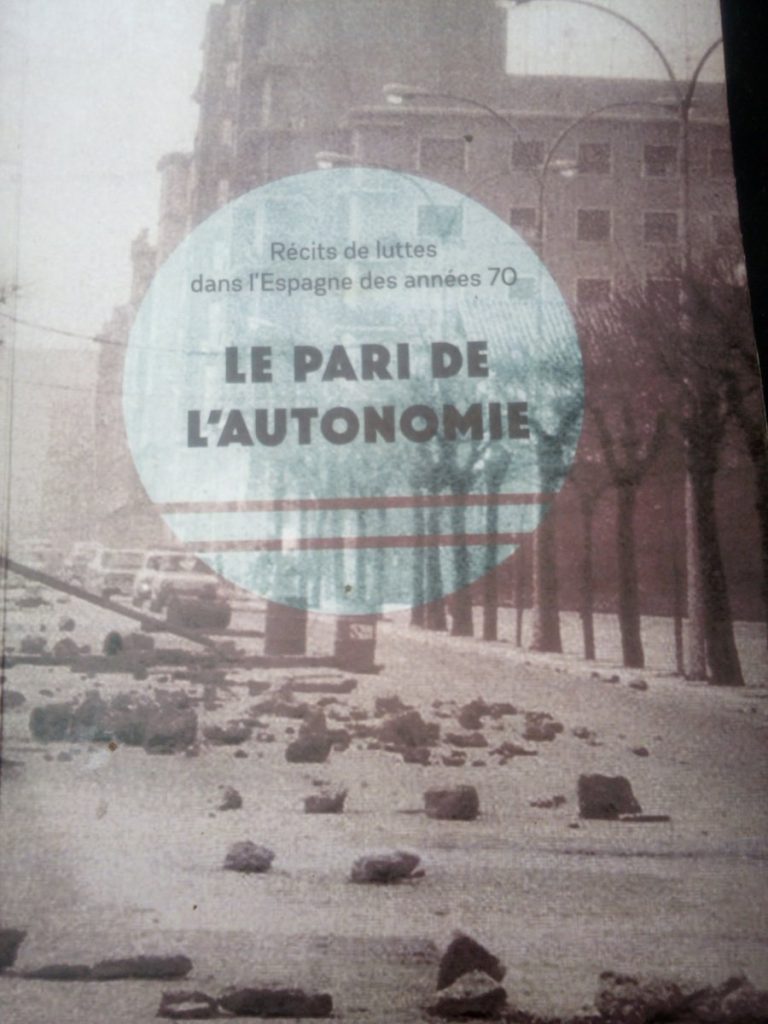

 Dans la nuit de jeudi 16 août à vendredi 17, une caméra de vidéosurveillance a été détruite dans le quartier du Parc à Roanne (Loire). La nuit suivante, une seconde a subi le même sort : « Un individu a grimpé le long du mât avec un bâton pour la casser. Il a pris la fuite à l’arrivée de la BAC, protégé par d’autres jeunes qui ont jeté des cailloux sur le véhicule de police avant de s’enfuir eux aussi. »
Dans la nuit de jeudi 16 août à vendredi 17, une caméra de vidéosurveillance a été détruite dans le quartier du Parc à Roanne (Loire). La nuit suivante, une seconde a subi le même sort : « Un individu a grimpé le long du mât avec un bâton pour la casser. Il a pris la fuite à l’arrivée de la BAC, protégé par d’autres jeunes qui ont jeté des cailloux sur le véhicule de police avant de s’enfuir eux aussi. »